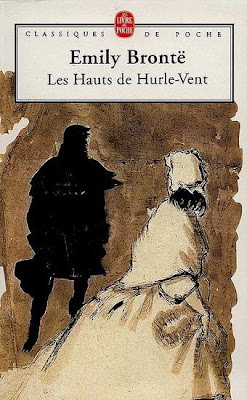Mais chez elle, justement, ne réside pas la parfaite petite famille américaine telle que le cinéma ou la télévision nous l'ont décrite : pas de gentille mère au foyer préparant des pâtisseries pour gâter la petite Coraline, pas de père bricoleur avec qui inventer toutes sortes de jeux. Coraline, qui n'aspire à rien d'autre que jouer dehors, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, a en effet là un gros problème : ses parents sont des geeks.
Tous deux botanistes occupés à la rédaction d'un livre sur les plantes, ils n'ont jamais mis un pied dans le jardin et ne connaissent pour tout horizon que les mégapixels qui composent leur écran d'ordinateur.
Mais la nuit, Coraline , grâce à la découverte d'une étrange poupée offerte par son ami-malgré-elle Wybee, s'aventure comme Alice à la poursuite du Lapin blanc, dans un étrange tunnel menant sur un autre monde qui ressemble comme deux gouttes d'eau au pays des merveilles. Là ses parents sont au petits soins pour elle, le jardin est féérique, Wybee est muet. Bref, “tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté”...
Sauf que ce monde n'est accesible pour de bon qu'à condition de se coudre des boutons sur les yeux... Alors Coraline n'est pas la seule à frissonner devant le spectacle de ce conte cruel, qui comporte son lot d'enfants-fantômes asservis, de sorcière féroce, et de créatures cauchemardesques. Car le songe dans lequel nous emmène Henry Selick, réalisateur de L'Etrange Noël de M. Jack bouleverse intelligemment les repères moraux qui balisent habituellement les films à destination des enfants. Coraline, c'est peut-être en effet une leçon d'éducation à l'usage des parents. A l'heure du web 3.0, alors qu'on s'inquiète de voir les enfants se précipiter de plus en plus tôt sur des ordinateurs et des consoles de jeu vidéo, où les relations sociales semblent se virtualiser, Coraline, elle, ne rêve que de rapports familiaux et de jeux de plein air.
Voir son enfant s'amuser et s'épanouir au soleil ne semble-t-il pas paradoxalement le rêve de tout parent ? Henry Selick, lui, renverse ce postulat en nous décrivant des parents qui voudraient cloîtrer le plus possible leur fillette dans une vieille maison un peu lugubre afin de pouvoir travailler en étant sûrs de n'être pas dérangés. Aussi, lorsque ceux-ci disparaissent, kidnappés par la sorcière, l'environnement de la fillette ne s'en trouve pas tellement perturbé ; certes celle-ci veut les récupérer, parce qu'elle les aime. Mais elle ne peut les aimer que malgré leur fadeur, quand elle-même regorge de fraîcheur et d'imagination.
Les Parents Pauvres de l'Imaginaire enfantin
Cette réflexion est particulièrem ent intéressante dans la mesure où elle caractérise très souvent la peinture du monde adulte dans les œuvres contemporaines pour la jeunesse : les parents, tuteurs, adultes censés responsables, y sont la plupart du temps des personnages ternes, bornés, limités, inutiles et par conséquent généralement bien peu adjuvants. Ces “parents terribles”, largement dépassés par la créativité constante du monde enfantin, se retrouvent en outre aussi bien en littérature qu'au cinéma. Ainsi les adultes de la trilogie A la Croisée des mondes, de Phillipe Pulman, mutilent les enfants au nom de principes théologiques ; le responsable légal des Orphelins Baudelaire, Mr Poe, confie sans cesse les enfants à des crapules qui veulent les détrousser, quitte à les tuer. Quant aux parents adoptifs d'Harry Potter, les Dursley, ce serait peu dire qu'ils sont étroits d'esprit et souffrent d'une incroyable absence d'imagination. Même si Coraline est plus soft, avec ses parents « geeks », le film pose néanmoins une nouvelle fois cette interrogation. Pourquoi les parents sont-ils toujours si désespérément creux et prosaïques ? Assiste-t-on, comme l'ont asséné certains hommes politiques ces dernières années à une sorte de victoire hégémonique du paradigme-Dolto, de telle sorte que c'est l'enfant-roi devenu tout-puissant, donc tyrannique, qui entreprend à présent l'éducation de ses parents ? Les auteurs pour la jeunesse essaient-ils ainsi de renouer un lien avec un monde dont ils ne font plus partie, mais dont ils essaient de retrouver les clefs ? Et si nous avions tous peur, une fois grandis, de ne plus pouvoir jouer à « On dirait que tu serais... » ? Si notre égarement dans la course du temps nous effrayait tellement qu'il nous fallait réapprendre à être un enfant, et à retrouver la féerie qui caractérise à cet âge la vision du monde ?
ent intéressante dans la mesure où elle caractérise très souvent la peinture du monde adulte dans les œuvres contemporaines pour la jeunesse : les parents, tuteurs, adultes censés responsables, y sont la plupart du temps des personnages ternes, bornés, limités, inutiles et par conséquent généralement bien peu adjuvants. Ces “parents terribles”, largement dépassés par la créativité constante du monde enfantin, se retrouvent en outre aussi bien en littérature qu'au cinéma. Ainsi les adultes de la trilogie A la Croisée des mondes, de Phillipe Pulman, mutilent les enfants au nom de principes théologiques ; le responsable légal des Orphelins Baudelaire, Mr Poe, confie sans cesse les enfants à des crapules qui veulent les détrousser, quitte à les tuer. Quant aux parents adoptifs d'Harry Potter, les Dursley, ce serait peu dire qu'ils sont étroits d'esprit et souffrent d'une incroyable absence d'imagination. Même si Coraline est plus soft, avec ses parents « geeks », le film pose néanmoins une nouvelle fois cette interrogation. Pourquoi les parents sont-ils toujours si désespérément creux et prosaïques ? Assiste-t-on, comme l'ont asséné certains hommes politiques ces dernières années à une sorte de victoire hégémonique du paradigme-Dolto, de telle sorte que c'est l'enfant-roi devenu tout-puissant, donc tyrannique, qui entreprend à présent l'éducation de ses parents ? Les auteurs pour la jeunesse essaient-ils ainsi de renouer un lien avec un monde dont ils ne font plus partie, mais dont ils essaient de retrouver les clefs ? Et si nous avions tous peur, une fois grandis, de ne plus pouvoir jouer à « On dirait que tu serais... » ? Si notre égarement dans la course du temps nous effrayait tellement qu'il nous fallait réapprendre à être un enfant, et à retrouver la féerie qui caractérise à cet âge la vision du monde ?
De ce point de vue, Coraline apparaît plutôt cynique : non seulement l'adulte y est tellement terne qu'il est voué à la disparition, mais c'est l'enfant lui-même qui choisit ses propres parents, en désobéissant constamment à l'une ou à l'autre des autorités qui essaient de s'imposer à lui.
Et l'on ressort de ce dessin animé un peu mal à l'aise, comme on l'était lorsque nos parents, à la fin d'Hansel et Gretel, nous racontaient comment les deux enfants, sûrs de leur bon droit, poussaient la méchante sorcière dans le four avant de s'enfuir. Car les derniers mots que crie la sorcière du film avant que la fillette ne la fasse engloutir dans l'univers qu'elle a elle-même créé sont « Je t'en prie, laisse-moi t'aimer ! »
Tout est bien qui finit bien ? Le monde normal de Coraline, dans lequel elle a ramené ses parents, paraît étrangement angoissant, et l'on éprouve une certaine compassion pour la sorcière... Tout cela n'était-il qu'un cruel jeu d'enfants ?
Prenez garde, parents inattentifs, malgré leurs joues roses et leur rafraîchissante candeur, vos bambins ne sont peut-être pas si innocents que ça...