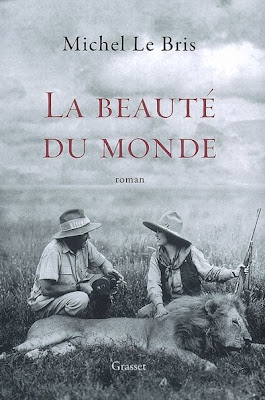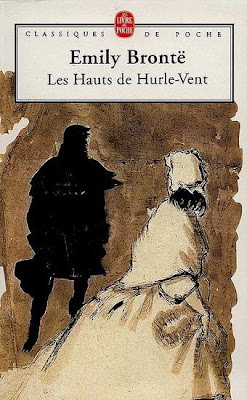Mais ici dans ce blog, je suis chez moi et je peux tout me permettre. (L'avantage d'être chez soi...)
Aussi, succombons un peu au plaisir de l'écriture digressive...
Or donc, j'étais hier à la MJC Pichon, au concert d'Anna C et les Méchants Garçons. Un groupe pour lequel je fais le maximum de pub possible : Normal, la chanteuse, c'est ma soeur. Outre ses propres compositions, le groupe nous a gratifié de quelques reprises : Ray Charles, Gainsbourg, The Spencer Davis Group... Mais là où les larmes ont failli me gagner, c'est quand Anne a conclu le concert, après les rappels, par Stormy Weather, une chanson de Billie Holiday. C'était traître : Billie me fait toujours fondre. Je l'appelle Billie, parce que c'est ainsi ; les artistes que j'admire, je les appelle par leurs prénoms. Il y a donc notamment, outre Billie, Bob*; John, Paul, George et Ringo**; Joan***...
Mais revenons à Billie. A vrai dire, Billie n'est pas l'auteur de Stormy Weather. Cette petite merveille est dûe à Harold Arlen et Ted Koehler, deux talentueux compositeurs de jazz qui se rencontrent au mythique Cotton Club, à Harlem, pour lequel ils écrivent des succès devenus des standards de 1930 à 1934. Stormy Weather, composé en une demi-heure selon la légende, est au départ destinée à Cab Calloway, mais c'est finalement Ethel Waters - cette même Ethel Waters, que l'on entend si je ne m'abuse, chanter dans un mémorable passage de La Beauté du Monde, le superbe roman de Michel Le Bris dont j'ai déjà parlé ici - qui l'interprète pour la première fois au Cotton Club. Plus tard, Ella Fitzgerald chantera aussi la pluie depuis que son homme l'a quittée. Mais on se souvient avant tout de la version de Billie. Car la voix de Billie a cela de particulier qu'une fois qu'on l'a entendue, on ne peut plus l'oublier. Peu importe que ses morceaux soient signés Gershwin : son talent éclipse tout le reste, l'émotion submerge, dès lors la chanson n'appartient plus à son auteur ; c'est une chanson de Billie Holiday et tous les interprètes qui la suivent ne peuvent faire autre chose qu'une reprise de Billie Holiday.
La Dame aux Gardé
 nias
niasPourtant, bien avant que le rock n'en fasse un mode de vie, celle que Lester Young appelle
affectueuse-
ment Lady Day a abîmé
sa voix exceptionnelle
dans la drogue et l'alcool. Une voix qui lui était
venue on
ne sait comment.
Eleonora Fagan était née à Baltimore en 1915 de Sadie Fagan, 19 ans, et de Clarence Holiday, 17 ans. Guitariste de jazz, son père écume les clubs, n'épousera pas sa mère, ne reconnaîtra pas son enfant. A l'époque où nait Eleonora qui n'est pas encore Billie, les États-Unis sont loin de passer pour le pays le plus cool de la planète. Le président américain n'est pas noir. A vrai dire, dans les états du Sud, où Abraham Lincoln n'est pas un personnage historique très aimé, il n'est pas rare de voir un Noir se balancer aux branches d'un arbre. Déco charmante dûe à l'activisme fervent du Ku Kux Klan, qui inspire en 1939 à Lewis Allan un poème dont Billie donnera une interprétation bouleversante - elle-même ne peut généralement le chanter sans pleurer - Strange Fruit.
L'enfance de Billie ressemble à la plus glauque des chansons de blues : son arrière-grand-mère meurt alors qu'elle fait la sieste dans ses bras ; sa mère, qui se prostitue pour subsister, ne peut pas l'élever, Eleonora est donc trimballée de foyer en foyers ; à dix ans, alors qu'elle est chez sa mère et que celle-ci est absente, elle est violée par un voisin ; à treize ans, elle est femme de ménage dans un bordel. Mais à quinze ans, découvrant le jazz à Harlem, elle retrouve son père, et commence à chanter avec lui, prenant le pseudonyme sous lequel on la connait encore.
En 1933, John Hammond (pas celui de Jurassic Park !) la découvre dans un club de Harlem et la fait enregistrer avec Benny Goodman.
Très vite, elle chante avec les plus grands artistes et les plus grands orchestres : Bobby Henderson, Lester "Prez" Young, Duke Ellington, Ben Webster, Teddy Wilson, Count Basie et Artie Shaw, dont tous les musiciens sont blancs ! Cependant, Lady Day ne peut tourner longtemps avec son orchestre, car sa couleur de peau lui interdit les hôtels et restaurants des états du Sud. Peu à peu, l'Amérique tout entière s'entiche de la voix de Billie. Ses cheveux toujours parés de gardénias, elle est grâcieuse et belle. La misère la guette toujours, cependant : elle commence à boire, à fumer de la marijuana. Les années 1940 s'écoulent entre drogue, alcool, mariages ratés, désespoir lorsque la Lady Day apprend le décès de sa mère, et un séjour en prison dû à tous ces excès.
Ce n'est que dans les années 50 qu'elle fait un retour fracassant grâce au label The Verve. Interdite de se produire à New York à cause de ses frasques, elle en profite pour réaliser un vieux rêve : une tournée en Europe, qui l'amène pour deux dates à Paris. Une venue que Boris Vian salue avec chaleur dans ses Chroniques de Jazz. Tentant d'expliquer pourquoi Billie Holiday est incomparable, il écrit :
"On aime ou on n'aime pas la voix de Billie Holiday, mais quand on l'aime, c'est à la façon d'un poison. Ce n'est pas la chanteuse qui vous fiche tout de suite le gros choc imparable dont on ne se remet pas. La voix de Billie, espèce de philtre insinuant, surprend à la première audition. Voix de chatte provocante, inflexions audacieuses, elle frappe par sa flexibilité, sa souplesse animale - une chatte les griffes, rentrées, l'œil mi-clos - ou pour faire une comparaison bougrement plus brillante, une pieuvre. Billie chante comme une pieuvre. Ça n'est pas toujours rassurant d'abord ; mais quand ça vous accroche, ça vous accroche avec huit bras. Et ça ne lâche plus. (D'ailleurs il n'y a pas d'animal plus folâtre et plus câlin que la pieuvre, ainsi qu'en témoignent les films de Cousteau, explorateur sous-marin.)"
En 1956, la Dame aux Gardénias publie ses mémoires, Lady Sings The Blues, dont un film avec Diana Ross sera tiré. Certains détails y sont romancés : il est vrai que son existence a été suffisamment remplie pour alimenter toute une saga...
Mais à la fin des années 1950, Billie, malade depuis déjà longtemps, est rongée par une cyrrhose du foie, une insuffisance rénale qui se transforme bientôt en infection et une congestion pulmonaire. Lorsque Lester Young meurt en 1959, Lady Day est déjà gagnée par la nuit. Elle se consumme et s'éteint le 17 juilet 1959, à l'âge de 44 ans.
L'Art de se Perdre...
Comme beaucoup d'artistes avant ou après elle (Ray Charles, Johnny Cash et nombre de rockeurs à leur suite, sont connus pour avoir sombré face aux mêmes addictions), Billie Holiday s'est perdu
 e dans ce que Baudelaire nommait "les paradis artificiels". Pour autant, faut-il en déduire que la malédiction colle à la peau des artistes ? Robert Johnson avait peut-être vendu son âme au diable pour le talent de la guitare, mais si tel était le cas, il l'avait fait consciemment. Qui pourrait reprocher à Billie d'avoir cherché à s'égarer quand sa vie fut dès son plus jeune âge, si difficile ? Mais, m'objectera-t-on, la musique ne pouvait-elle la sauver ?
e dans ce que Baudelaire nommait "les paradis artificiels". Pour autant, faut-il en déduire que la malédiction colle à la peau des artistes ? Robert Johnson avait peut-être vendu son âme au diable pour le talent de la guitare, mais si tel était le cas, il l'avait fait consciemment. Qui pourrait reprocher à Billie d'avoir cherché à s'égarer quand sa vie fut dès son plus jeune âge, si difficile ? Mais, m'objectera-t-on, la musique ne pouvait-elle la sauver ?J'ai vu récemment un film au cinéma, intitulé Un Soir au Club. Entré par hasard dans un club de jazz, un ancien musicien s'y noyait. Peut-on se perdre dans la musique ? Peut-on se saouler de mélopées et de refrains, jusqu'à s'y engloutir corps et âme ? Sûrement, oui, surtout si l'on a l'âme sensible.
Boris Vian avait bien raison lorsqu'il écrivait que la voix de Billie était un poison. Elle envoûte, contamine, paralyse, et ses effets sont permanents. Voilà pourquoi personne ne parvient à la faire oublier. Bien conscients de s'y perdre, on la réclame encore et encore.
__________________________________________________________________
* Dylan, bien sûr.
** Ai-je vraiment besoin de préciser les noms de famille de ces quatre là ?
*** Baez, que je ne désespère pas de voir enfin en concert un jour...